Pourquoi est-ce important de s’intéresser au psychisme du poulpe ?
Nous percevons le monde et agissons à l’aide de cinq sens dont le calibrage et l’importance relative sont le résultat d’une histoire évolutive singulière. Au-delà des frontières de notre espèce, la diversité sensorielle du monde animal est immense, et elle nous échappe très largement. Nous ne saurons jamais, par exemple, à quoi ressemble la couleur ultraviolette. En se livrant sur plus de 400 pages à l’inventaire de cette diversité, An Immense World se donne pour mission de nous faire découvrir tout ce que nous ne percevrons jamais. Mais, au-delà de susciter un émerveillement un peu béat face à la richesse du Vivant, est-ce utile de connaître ce dont nous ne pourrons jamais faire l’expérience ? Voyons ça de plus près.
Le biologiste et philosophe allemand Jakob Von Uexküll a été l’un des premiers, au XIXème siècle, à battre en branche l’idée très judéo-chrétienne que le Vivant est une pyramide dont nous occupons le sommet. Lui voulait plutôt voir le règne animal comme une grande maison dont chaque habitant, confiné dans une chambre dont il ne sortira jamais, voit un paysage différent à travers sa fenêtre. C’est le concept d’Umwelt. Chaque espèce animale – et nous n’y faisons pas exception - est dotée d’un filtre sensoriel qui lui est propre, et lui permet de créer un modèle du monde unique et inconnaissable par les autres.
Signaux faibles
L’Umwelt humain résulte de la combinaison de cinq sens qui ne capturent qu’une infime partie des signaux qui leur parviennent.
Commençons par la vue. La lumière visible par l’homme constitue une mince tranche de spectre électromagnétique :
Malgré cela, nous sommes bien une espèce visuelle, et l’une des plus performantes. Nous sommes parmi les mieux dotés du règne animal pour ce qui relève du couple acuité / champ de vision. Il pourrait s’agir là d’une conséquence évolutive de la bipédie et de la vie dans les savanes aux horizons dégagés.
Et pourtant, malgré cet avantage, des pans entiers du monde visuel nous échappent. Prenons les couleurs. Ce que nous percevons comme du noir, ce sont bien souvent des couleurs que notre œil ne peut pas voir. Voici par exemple à quoi pourrait ressembler, à droite de l’illustration, un étourneau pour un de ses congénères sensible, contrairement à nous, aux ondes ultraviolettes1:
Nos limites sensorielles sont encore plus flagrantes dès lors qu’on parle de l’ouïe :
Nous ignorons l’essentiel des bruits de la nature. Il aura fallu des années aux chercheurs pour comprendre que les éléphants, qu’on croyait bêtement plantés là pendant des heures face à face et en silence, communiquaient en réalité de manière complexe par infrasons. Ou qu’une baleine pouvait produire dans les mers de Norvège un signal sonore audible par un congénère aux Bermudes, à plus 6000km. Ou encore que le son le plus puissant du règne animal - l’écholocalisation du cachalot, avec ses 236 dB (!) - était un ultrason que notre oreille ne pouvait percevoir.
Notre insuffisance auditive n’est pas que «spectrale ». Des mélodies entières nous échappent car elles sont produites à une vitesse si élevée que nous ne pouvons les capturer. Le chant du diamant mandarin est perçu par notre oreille comme une harmonie composée d’une succession de notes. Et pourtant, les chercheurs ont montré que ce petit oiseau était indifférent à ce qui constitue pour nous l’essence même d’une harmonie, à savoir l’ordre des notes. Car ce qui compte pour lui, ce sont les harmonies cachées qui se trouvent à l’intérieur de chaque note, et qui s’expriment à une cadence bien trop rapide pour notre oreille. Au vu de son hypersensibilité à des signaux imperceptibles pour nous, on peut penser que l’expérience du temps n’est pas la même dans l’Umwelt du diamant mandarin.
Des sens secondaires pour nous – comme le toucher et l’odorat - sont le centre de gravité cognitif d’autres espèces. C’est le cas pour le condylure étoilé, une taupe nord-américaine qui vit dans l’obscurité. Avec ses 22 tentacules nasaux, elle peut palper jusqu’à 13 objets différents à la fois, et ainsi reconstituer une image en 3D de son environnement, en mobilisant des aires sous-exploitées de son cortex visuel.
On peut prendre également l’exemple du serpent à sonnette, qui se fait une image du monde autour de lui, mais également des évènements du passé récent, en reniflant ses environs «en stéréo » à l’aide de sa langue fourchue.
Nos sens – y compris le plus aiguisés - sont donc largement sous-dimensionnés pour capter tout ce qui leur parvient. D’autres espèces captent ces signaux faibles, créant des Umwelten dont nous n’avons pas idée.
Ecoute active
Mais notre étroitesse sensorielle ne s’arrête pas là. Il y a les autres sens, ceux que nous ne possédons pas et qui produisent des modèles du monde plus exotiques encore.
La détection des vibrations est le moins étrange de ces sens « apocryphes ». Un phoque peut par exemple suivre un poisson à la trace, plusieurs dizaines de secondes après son passage, en se servant de ses moustaches pour détecter les turbulences aquatiques laissées par celui-ci. Comme pour le serpent à sonnette, l’étendue et la symétrie des moustaches du phoque lui permettent de reconstituer en « stéréo » non seulement l’environnement présent, mais également passé. Mais le monde des vibrations, c’est aussi celui des petites créatures auxquelles personne ne fait attention. Les cérèses buffles sont de petits insectes arboricoles insignifiants au premier abord. Pour communiquer, ils émettent des vibrations, qui retranscrites en sons à l’aide d’un simple appareil, se transforment en un chant qui n’a rien à envier à celui des baleines. Les squares de nos villes et les bosquets de nos campagnes bruissent donc bel et bien de mille petites symphonies insoupçonnées.
Mais il existe d’autre sens encore plus ésotériques. Notamment ceux qui requièrent une participation active de l’individu.
Contrairement à la vue, l’ouïe ou l’odorat, qui se contentent de traiter passivement les signaux qui leur parviennent, l’écholocalisation produit ses propres signaux et, se faisant, son propre monde. En émettant un ultrason puis en analysant l’écho qui lui revient, la chauve-souris et le dauphin peuvent cartographier leur environnement. Se repérer sans erreur dans le noir total d’une grotte exigüe. Chasser dans un banc de sardines. Voir à travers objets et tissus avec une précision que l’armée américaine n’a pas à date réussi à reproduire. Le Umwelt de la chauve-souris et du dauphin se construit en temps réel et sa précision est proportionnelle à l’effort qui est mis à le produire. Le revers de la médaille, c’est que produire son monde est fatigant, et que la chauve-souris aura tôt fait de s’empaler sur une stalactite si elle baisse la garde ne serait-ce qu’une seconde. Essayons une seconde d’imaginer un monde où on pourrait moduler, au prix d’un grand effort, la précision de notre vue par un simple acte de notre volonté…
L’autre sens qui requiert une participation active, c’est l’électrolocalisation, très présente chez les anguilles et poissons-chats. Le champ électrique est omniscient, infaillible et ne connaît pas d’obstacle. Sa contrepartie, c’est qu’il a une portée très limitée, et ne permet pas de détecter un mouvement au-delà de quelques dizaines de centimètres. Dans l’Umwelt des poissons qui vivent en eaux troubles, le temps de réaction, et donc la perception de l’écoulement du temps, se doit d’être bien plus rapide que chez nous, car la faiblesse de la portée du signal laisse très peu de temps pour agir.
Il existe, enfin, un sens si étrange qu’il s’apparente pour nous à un pouvoir surnaturel. Ce sens, c’est celui qui permet à des tortues de mer de retrouver leur lieu de naissance depuis l’autre bout du monde, ou encore aux sternes, monarques et grues de traverser des continents entiers pour arriver à une destination programmée à l’avance. Ce sens, c’est la magnétoréception, la sensibilité aux variations du champ magnétique de la Terre. Ce sens reste un mystère car l’organe sensoriel, malgré différentes pistes, n’a pas encore été identifié par la communauté scientifique. Nous ne comprenons tout simplement pas ce sens. Nous pouvons encore moins l’imaginer.
Les animaux voient des lumières invisibles. Ils produisent leurs mondes. Ils perçoivent les respirations magnétiques de la Terre. Ils peuvent saisir des objets avec leur nez, sentir avec la langue et voir avec leurs pattes. Toutes les combinaisons imaginables semblent exister. Sans surprise, cette diversité d’Umwelten donne naissance à une diversité d’intelligences, auxquelles il est vain de chercher à se mesurer.
Organisation tentaculaire
L’intelligence de la pieuvre est l’objet de beaucoup de fantasmes2. On aime rappeler qu’elle possède plus de neurones qu’un chat, suggérant ainsi la possibilité d’une comparaison. Celle-ci est pourtant vaine.
600 millions d’années d’évolution nous séparent de la pieuvre. Elle est invertébrée. Elle n’a pas de forme. Elle n’a pas un, mais neuf cerveaux. Un central, et un par tentacule. Et chacun des tentacules abrite à son tour une trentaine de ventouses elles-mêmes dotées d’un réseau neuronal dense et autonome. La pieuvre n’a pas de cerveau, elle est un cerveau. Une intelligence distribuée. Son modèle du monde repose sur un principe de subsidiarité en vertu duquel les niveaux inférieurs (ventouses, tentacules) transmettent au niveau supérieur l’information qu’il a besoin de connaître pour prendre une décision, et uniquement celle-ci (comme par exemple l’existence d’une proie, sans fournir le détail sur la forme ou la couleur exacte de celle-ci). La décision de s’engouffrer dans un trou minuscule est d’abord prise par un tentacule, puis le suivant, puis un autre, et encore un autre jusqu’à ce que la totalité de l’individu se faufile dans un passage que le cerveau central aurait peut-être jugé trop étroit. La plasticité du corps de la pieuvre doit sans doute beaucoup à cette décentralisation décisionnelle.
Le cerveau central de la pieuvre est donc un CEO qui sait déléguer. Bien des grands groupes et administrations pourraient s’inspirer, pour fonctionner avec plus de pragmatisme, d’efficacité et d’audace, du principe d’autonomisation décisionnelle de la périphérie qui régit le psychisme du poulpe.
So What ?
Au-delà de l’anecdote sympathique, de l’allégorie un peu facile, ou du salutaire rappel qu’il faut respecter le Vivant dans sa diversité, à quoi bon s’intéresser à tout ça? A quoi bon chercher à connaître et comprendre ce dont nous ne pourrons jamais faire l’expérience ? Wittgenstein nous l’a rappelé : « Si un lion pouvait parler, nous ne pourrions le comprendre » - nous rappelant par là que nous vivions dans des mondes parallèles et étanches. Les chercheurs qui ont consacré leur vie au groin de la taupe ou aux moustaches du phoque ne sont-ils que des « conquérants de l’inutile » ?
Je vois trois raisons de penser que non. Trois raisons d’ordre éthique peuvent nous conduire à nous intéresser davantage à ces mondes invisibles :
Décentrer le regard. Faire l’effort de connaître l’altérité la plus radicale, même si c’est une quête impossible, peut nous aider à faire une meilleure place dans nos vies à celle qui nous est un peu plus accessible, celle de nos “frères humains”. Faire l’effort de sortir de la chambre dans laquelle Uexküll nous a enfermés peut nous aider à sortir de nous-même. Et à reconnaître que la dignité d’Autrui réside justement dans le fait que son Umwelt nous est largement inaccessible. Que son point de vue est le résultat d’un chemin singulier qu’il faut a priori respecter. Et qu’il faut peut-être davantage “prendre les gens comme ils sont”;
Créer et protéger la « marge » : Dans les Racines du Ciel, Morel ne protège pas les éléphants pour sauver l’espèce ou protéger la biodiversité. Il le fait pour « créer une marge ». Pour laisser un espace de liberté et de dignité à la vie sauvage mais aussi et surtout à l’humanité. S’intéresser à, protéger et laisser prospérer ce qui n’est pas nous est pour Romain Gary un « statement » bien plus humaniste que tous les positivismes qui voyaient dans la Nature une création à asservir et à exploiter ;
Découvrir l’« infiniment présent» : Le spectacle à peine effleuré de ces mondes parallèles est une invitation à diriger notre attention sur un troisième infini. Cet infini n’est ni grand ni petit. Il n’est pas très loin et ne nécessite pas de prendre l’avion. Ce troisième infini, c’est celui de l’ici et du maintenant. De tous les mondes possibles. Et il ne demande qu’à être effleuré pour peu que restent éteints nos sonneries et nos notifications de nos smartphones.
Kant avait anticipé le concept d’Umwelt. Selon lui, la chose en soi est inaccessible car filtrée par les catégories a priori de la perception. Le seul chemin vers la connaissance du monde serait donc celui de la loi morale. A celle-ci, je préfère pour ma part une plus modeste éthique de l’inconnaissable et de l’émerveillement. Et tant pis si celui-ci est un peu béat.
Les couleurs du schéma ne veulent en soit rien dire. Il est impossible pour nous de se représenter une couleur en dehors du spectre visible








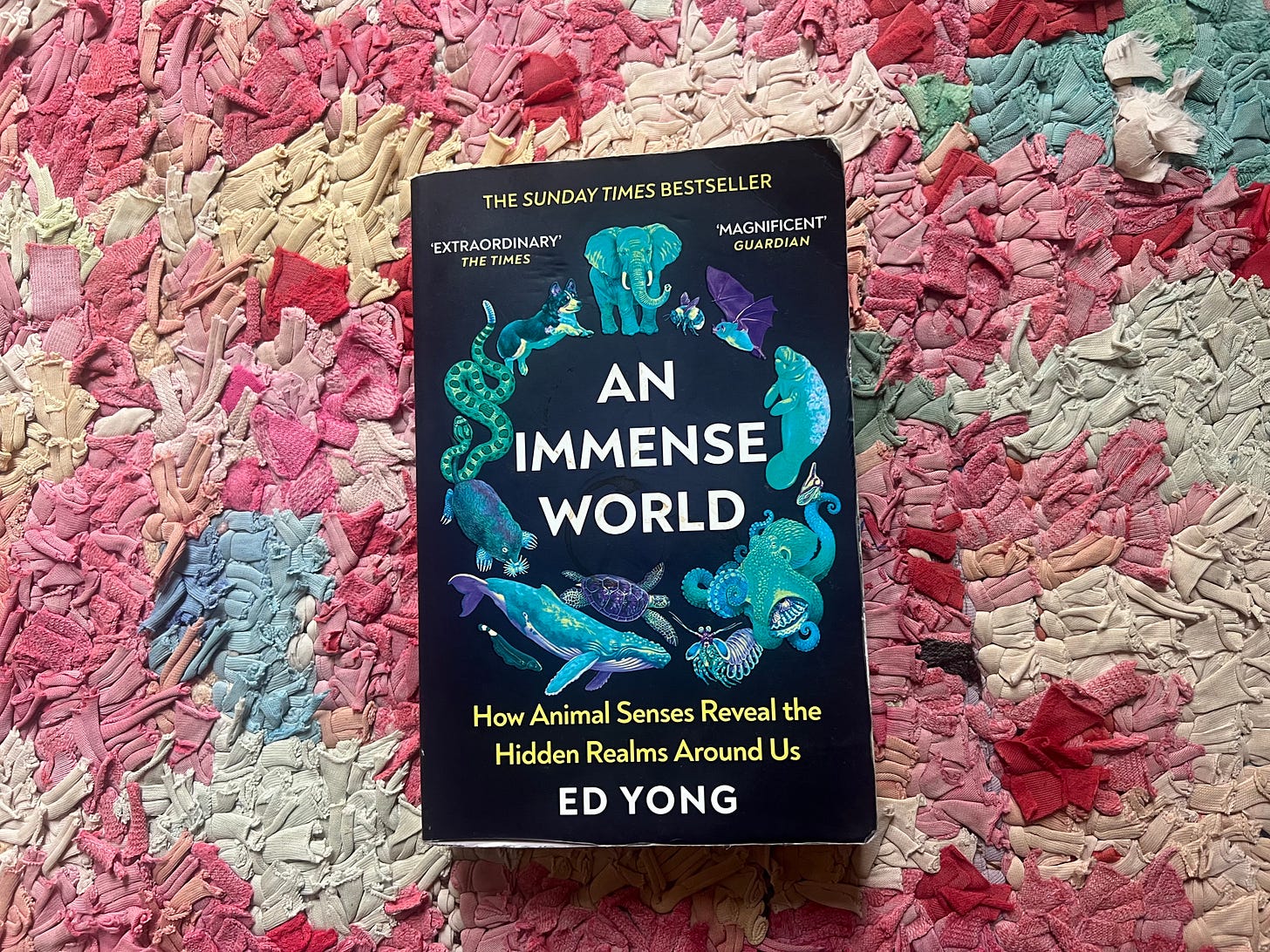
Fascinant cher Florian,as always 😀👏
Reading this beautifully written piece, I found myself deeply moved—and then, suddenly, confronted by a different kind of question.
What happens when our efforts to understand the Umwelten of others—of animals, insects, even ecosystems—lead not only to wonder and humility, but also to exploitation? When knowledge about the sensory world of the “other” is used not to respect it, but to dominate it? Where, then, do we draw the line between understanding and control?
Perhaps the “humble gaze” you evoke so powerfully is itself a kind of answer. A stance that insists that to truly see the other—whether human or nonhuman—is to resist the urge to assimilate or weaponize that knowledge.
This reflection stayed with me through a quiet weekend morning. I turned off my phone notifications and went for a walk in a nearby park—just a modest gesture, but perhaps enough to slightly open the chambers of my own perception. Thank you for the invitation to do so.